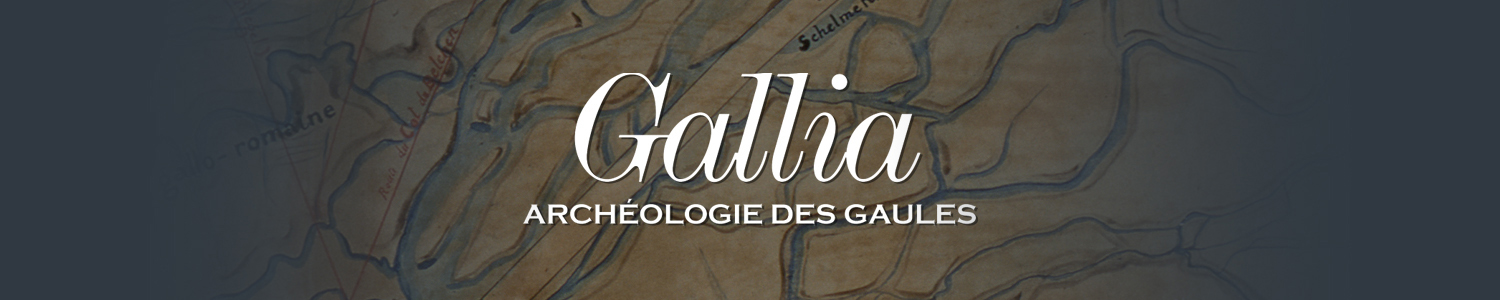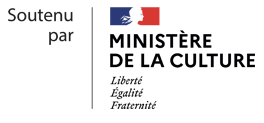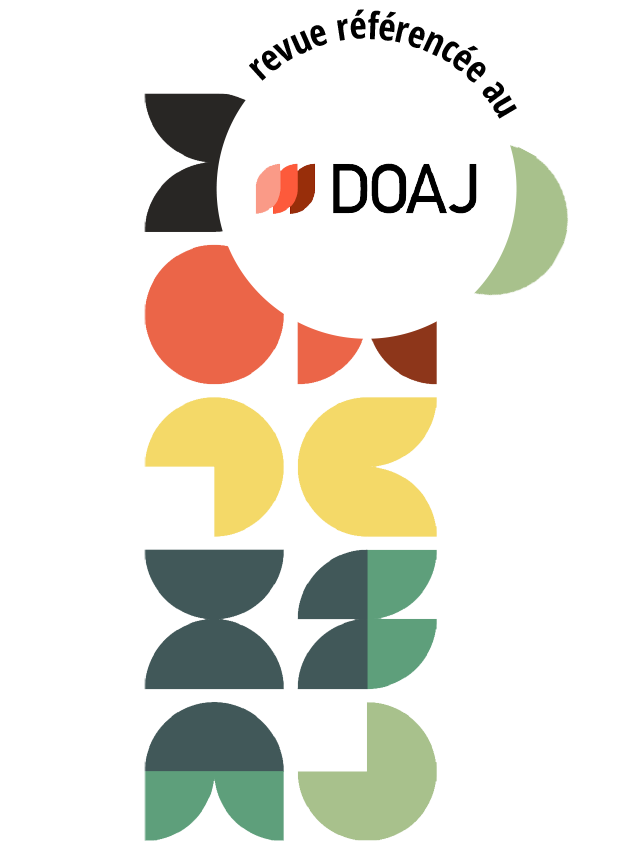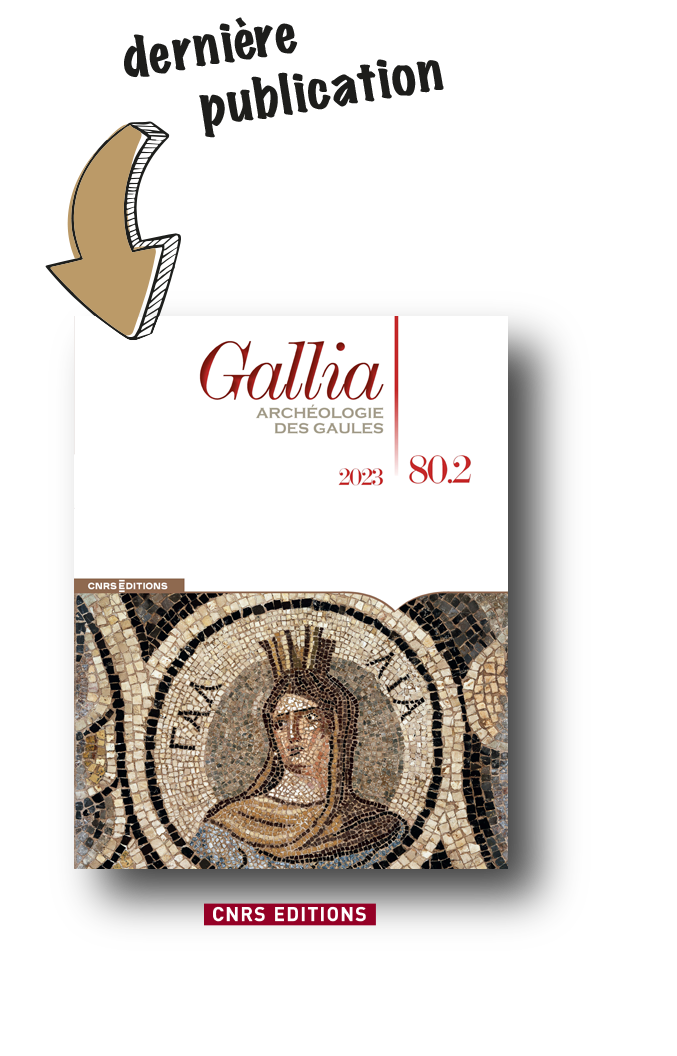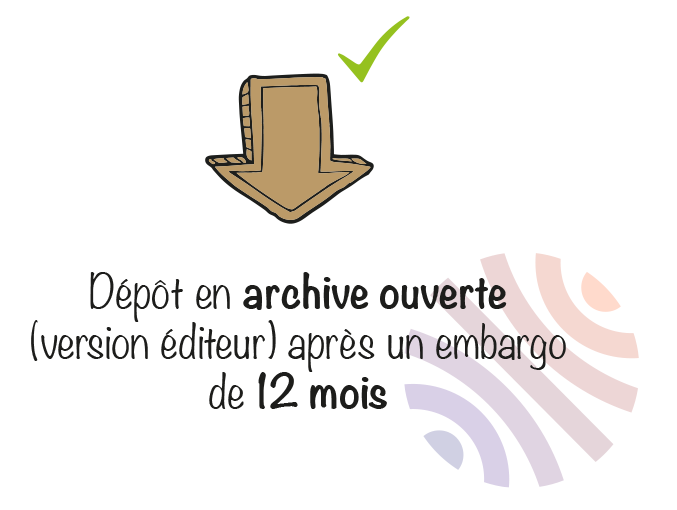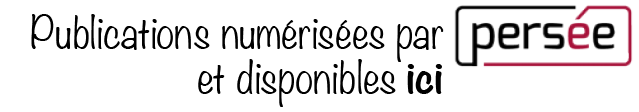Rédacteur en chef :
Sandrine Agusta-Boularot
Professeure des universités
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - ASM
gallia[at]cnrs.fr
Éditrice :
Raphaëlle Lamy
MSH Mondes - Pôle éditorial
raphaelle.lamy[at]cnrs.fr
+33 (0)1 46 69 26 13
Gestionnaire de la collection HAL :
Nicolas Coquet
MSH Mondes - Pôle éditorial
nicolas.coquet[at]cnrs.fr
+33 (0)1 46 69 24 23
La revue Gallia – Archéologie des Gaules (ISSN : 0016-4119 ; e-ISSN : 2109-9588) est la principale revue nationale d’archéologie antique, avec une forte audience internationale. Créée en 1943 par le CNRS, elle a pour mission de publier des dossiers et des articles de synthèse et également de faire connaître les résultats des principaux chantiers évalués par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) ou les Commissions territoriales de la recherche archéologique (CTRA). Revue d’archéologie, Gallia est ouverte, à propos de chaque site étudié, aux disciplines susceptibles d’élargir le champ de la recherche.
Son champ chronologique couvre la Protohistoire depuis le premier âge du Fer, l’Antiquité et l’Antiquité tardive jusqu’à la fin des royaumes mérovingiens. Son champ géographique recouvre l’ancien espace gaulois, soit les provinces romaines des Trois Gaules, la Narbonnaise, les Germanies, ainsi que les territoires immédiatement limitrophes qui participent à leur destinée.
Des Suppléments (ISSN : 0072-0119) publient des études monographiques, de grandes synthèses et des corpus (iconographiques, épigraphiques, etc.) présentant un intérêt majeur ou des avancées significatives pour l’archéologie et l’histoire des Gaules. Des séries, comme le Recueil général des mosaïques de la Gaule, les Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN) ou le Recueil des inscriptions gauloises (RIG), fonctionnent à la façon de collections et accueillent plus précisément les corpus.
La revue est soutenue par l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et par le ministère de la Culture (Direction générale des patrimoines et de l’architecture, Sous-direction de l'archéologie). Elle est coéditée par CNRS Éditions, qui en assure également l'impression et la diffusion.
Le secrétariat de rédaction est assuré au sein du pôle éditorial de la MSH Mondes (UAR 3225) à Nanterre.
* Les « Informations archéologiques » (publiées entre 1943 et 1986) ne sont pas référencées dans cette collection, mais sont néanmoins accessibles sur le portail Persée.